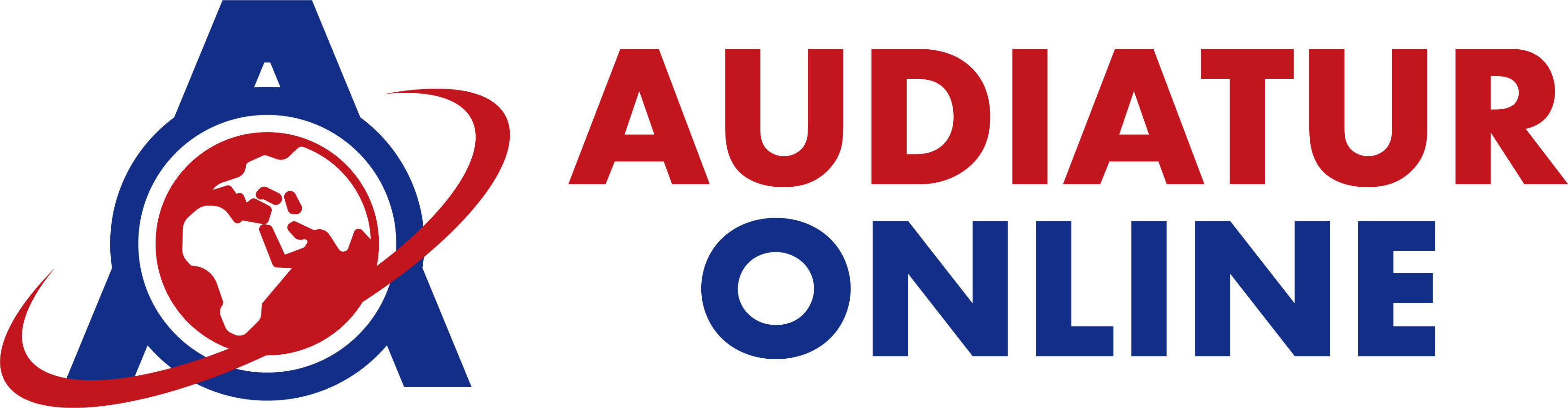Dans les débats actuels, le colonialisme est souvent considéré à travers le prisme des empires européens. L’héritage brutal des puissances coloniales espagnoles, britanniques, françaises et autres puissances européennes est bien documenté et vivement critiqué. La traite transatlantique des esclaves, l’exploitation des ressources et la destruction culturelle ont été condamnées à juste titre. Mais il existe une lacune évidente : l’histoire impérialiste du monde arabe.
Par Jan Kapusnak
Alors que le colonialisme européen est sans cesse remis en question, les siècles de conquêtes et de domination arabes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) sont souvent minimisés, ignorés ou romantisés. Dans certains cercles, les conquêtes arabes sont célébrées comme « l’âge d’or de l’islam », mettant en avant les réalisations intellectuelles et culturelles tout en minimisant les aspects impérialistes.
Conquêtes oubliées : l’impérialisme arabe et ses conséquences
Lorsque les armées arabes ont quitté la péninsule arabique au VIIe siècle, elles ont créé un empire qui, en moins d’un siècle, était plus grand que l’Empire romain. Vers 750 après J.-C., elles contrôlaient 13 millions de kilomètres carrés, régnaient sur 50 millions de personnes et ont redessiné les cartes de trois continents. Cette expansion impérialiste allait remodeler tout le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et au-delà. La première communauté musulmane, sous la direction du prophète Mahomet et de ses successeurs immédiats, aspirait à répandre l’islam non seulement comme religion, mais aussi comme système politique, avec pour objectif d’étendre la domination musulmane sur le monde connu.
L’expansion arabe était motivée par un mélange de ferveur religieuse, d’ambitions politiques et de conquêtes impérialistes. Un aspect central de l’essor de l’islam était la notion de Dar al-Islam (la « maison de l’islam »), un espace où la domination musulmane et les enseignements du Coran avaient la priorité absolue, et de Dar al-Harb (la « maison de la guerre »), les pays hors du contrôle musulman. Cette dichotomie a façonné une grande partie de l’expansion initiale de l’État islamique. Les campagnes militaires étaient justifiées comme une mission divine visant à placer des territoires sous contrôle musulman, la conquête territoriale étant présentée comme un devoir sacré.
Ce système de conquête impérialiste ne visait pas simplement à présenter une nouvelle religion aux peuples. Il s’agissait plutôt de réorganiser les sociétés en modifiant fondamentalement leur gouvernement, leur culture et leur identité. Les territoires conquis étaient restructurés autour d’un système de gouvernement complexe et souvent répressif. Les populations non musulmanes se voyaient attribuer le statut de dhimmi, ce qui faisait d’elles des citoyens de seconde zone, avec des droits limités et des impôts élevés, comme la jizya. Elles étaient contraintes de vivre sous des lois qui renforçaient la supériorité politique et sociale des musulmans. La tolérance sous l’islam a souvent été présentée comme la marque distinctive de son règne, mais uniquement à condition que la domination musulmane reste incontestée.
Le coût humain de l’impérialisme arabe a été énorme. En 639 après J.-C., les armées arabes ont conquis l’Égypte, constituée en majorité de chrétiens coptes. Certains chefs religieux, comme le patriarche Benjamin, ont coopéré avec les envahisseurs, mais de nombreux Coptes ont subi des violences brutales. Le chroniqueur Severus ibn al-Muqaffa décrit comment les Arabes « ont dévasté le pays », incendié des forteresses et massacré des moines. De nombreux Coptes ont été contraints de se convertir à l’islam ou ont subi de sévères restrictions. Le bouleversement culturel a décimé la population copte, qui est devenue minoritaire au Xe siècle.
La situation était similaire en Mésopotamie (la région qui correspond aujourd’hui à l’Irak), où la chute de l’empire sassanide face aux Arabes en 651 après J.-C. marqua la quasi-disparition du zoroastrisme, l’ancienne religion de la région. Les temples zoroastriens furent détruits, les écritures sacrées brûlées et les pratiques religieuses interdites. Les Arabes ont mis en place une nouvelle administration islamique et, en quelques siècles, le zoroastrisme s’est réduit à une petite minorité. La civilisation sassanide, autrefois si fière, avec ses riches contributions culturelles et intellectuelles, a été engloutie par l’impérialisme arabe.
En Afrique du Nord, les communautés autochtones amazighes du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et de Libye ont connu un long processus d’arabisation et d’islamisation. À l’origine polythéistes, leurs cultures et leurs identités ont été marginalisées par la propagation des normes arabes et la domination islamique. De nombreux Amazighs ont été intégrés dans l’armée arabe, tandis que leurs cultures ont été supplantées. Ce processus conduit encore aujourd’hui à une lutte pour la préservation de leur identité et de leur langue.
L’esclavage méconnu : 1200 ans d’exploitation arabe de l’Afrique
Un aspect particulièrement important, mais souvent négligé, de l’impérialisme arabe est la traite négrière arabe, qui a duré plus de 1 200 ans, bien plus longtemps que la traite transatlantique, qui domine l’historiographie occidentale. Ce chapitre sombre de l’histoire reste largement méconnu aujourd’hui, contrairement aux récits largement débattus de la colonisation et de la traite négrière européennes.
Entre 10 et 18 millions d’Africains ont été capturés, réduits en esclavage et transportés à travers le Sahara et la mer Rouge vers la péninsule arabique et la Perse. Alors que les marchands d’esclaves européens sont souvent condamnés pour leur rôle dans la traite transatlantique, la traite arabe est rarement abordée dans les débats historiques.
Ce commerce a dévasté les cultures africaines et entraîné une perte massive de potentiel humain. Les Zanj (peuples bantous de la côte swahili), déportés d’Afrique orientale vers le sud de l’Irak pour travailler dans les plantations, en sont un exemple frappant. Leur résistance a culminé avec la rébellion des Zanj en 869 après J.-C., l’un des plus grands soulèvements contre l’esclavage arabe. Bien qu’ils aient été vaincus, cette rébellion a montré les effets profonds de la traite sur les communautés africaines, les séparant de leurs pays d’origine et de leurs cultures.
Le colonialisme à deux vitesses : pourquoi la culpabilité de l’Europe est soulignée et le silence de l’Arabie entretenu
Cependant, les chercheurs et militants occidentaux qui s’intéressent au colonialisme européen considèrent souvent celui-ci comme exclusivement européen, tandis que l’impérialisme arabe est célébré comme « l’âge d’or de l’islam ». La violence des conquêtes arabes, associée à des conversions forcées et à l’oppression culturelle, est largement ignorée. Des personnalités telles qu’Avicenne, Averroès et Al-Khwarizmi sont célébrées pour leurs contributions révolutionnaires dans les domaines de la science, de la médecine, de la philosophie et des mathématiques. Cependant, ces réalisations sont souvent mises en avant sans aborder la question de la violence et de la discrimination à l’égard des non-musulmans.
Cet héritage du Dar al-Islam perdure encore aujourd’hui. Le nationalisme arabe et les mouvements islamistes continuent d’affirmer que le Moyen-Orient « appartient » aux Arabes et exigent des minorités qu’elles se soumettent. C’est comme si l’histoire de la région avait commencé avec l’essor de l’islam au VIIe siècle et que tout ce qui l’avait précédée – Juifs, Coptes, Perses et Assyriens – avait été effacé. Des nations qui avaient prospéré pendant des siècles ont été englouties par l’expansion de la domination arabe et leurs cultures marginalisées.
La persécution continue des Coptes en Égypte, l’oppression des Kurdes en Syrie et en Irak, l’extermination presque totale des chrétiens assyriens et le génocide des Yézidis par l’État islamique reflètent la mentalité impérialiste de conquête. Des groupes tels que le Hamas, l’EI et les talibans continuent d’appeler à la séparation entre Dar al-Islam et Dar al-Harb afin de justifier des conflits sans fin et le terrorisme sous le couvert du devoir religieux.
Aujourd’hui, critiquer l’impérialisme arabe, c’est risquer d’être taxé d’« islamophobie ». En revanche, condamner le colonialisme occidental est encouragé, car cela s’inscrit bien dans les cadres prétendument progressistes et antiracistes du monde universitaire occidental.
Cette asymétrie conduit à une conscience historique déformée. Le Levant et l’Afrique du Nord sont souvent considérés comme « naturellement arabes », comme si l’identité arabe était indigène. Mais ces régions n’étaient pas des « pays arabes » ; elles ont été arabisées par la conquête et l’oppression culturelle.
Dans le même temps, le nationalisme arabe, en particulier au XXe siècle avec des figures telles que Gamal Abdel Nasser, s’est positionné comme un mouvement de décolonisation visant à libérer le monde arabe de l’influence persistante des puissances européennes. Mais le nationalisme arabe lui-même était profondément enraciné dans l’héritage de l’ancien impérialisme arabe. L’identité arabe moderne, telle qu’elle a été construite par les nationalistes, efface souvent la diversité des cultures et des ethnies qui existaient dans la région avant les conquêtes arabes.
La persécution des minorités dans le Moyen-Orient moderne s’inscrit dans la continuité de la pensée impériale établie lors des conquêtes arabes. Dans des pays comme l’Égypte, la Syrie et l’Irak, les minorités non arabes et non musulmanes sont toujours victimes de discrimination et de violence systématiques. Le peuple kurde, dont la présence dans la région remonte à des millénaires, continue de lutter pour sa reconnaissance et son autonomie, mais ses représentants sont traités comme des citoyens de seconde zone par les gouvernements turcs et arabes majoritaires, qui considèrent l’identité kurde comme une menace pour l’unité nationale.
Israël comme antithèse : le retour du peuple indigène au lieu du colonialisme
De manière absurde, Israël est régulièrement accusé de « colonialisme », ce qui constitue un renversement grotesque de la réalité. Le sionisme n’est pas du colonialisme ; c’est le mouvement anticolonial le plus réussi de l’histoire : le retour d’un peuple indigène sur sa terre ancestrale après des siècles de domination étrangère. Qualifier l’autodétermination juive de « colonialisme » tout en ignorant les conquêtes arabes qui ont arabisé et islamisé la région est non seulement intellectuellement malhonnête, mais aussi une forme d’effacement historique dirigé contre la seule nation du Moyen-Orient qui ait réussi à se décoloniser. (Jan Kapusnak, politologue spécialisé dans le Proche-Orient)
Parmi les nombreux groupes minoritaires du Moyen-Orient, les Juifs d’Israël constituent une réussite remarquable. Après des siècles d’expulsion, de persécution et de migration massive, la création d’Israël en 1948 a offert un refuge aux Juifs longtemps marginalisés dans les pays arabes. Contrairement à d’autres minorités, la communauté juive d’Israël a non seulement survécu, mais elle s’est épanouie. La renaissance de l’hébreu, le rétablissement des pratiques religieuses juives et la construction d’Israël en une démocratie florissante témoignent de la résilience d’un peuple qui a refusé d’être anéanti. Cela contraste fortement avec d’autres groupes minoritaires au Moyen-Orient, qui ont été expulsés, privés de leurs droits ou assimilés à la majorité arabo-islamique.
Le débat sur le colonialisme reste manifestement partial. Alors que les crimes coloniaux de l’Europe sont examinés en détail, les conquêtes arabes qui ont transformé l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont souvent célébrées. Ce silence n’est pas une omission, mais une décision motivée par des considérations politiques. Il alimente l’illusion selon laquelle l’impérialisme serait exclusivement occidental, alors qu’en réalité, il a marqué toute l’histoire de l’humanité.
Tout comme il serait inapproprié d’ignorer les crimes coloniaux des empires européens, il est tout aussi essentiel de reconnaître l’histoire violente de l’expansion arabe et ses effets persistants sur les cultures minoritaires dans le monde arabe d’aujourd’hui. Cela donne une voix aux nations oubliées telles que les Coptes, les Amazighs et les Assyriens, dont les souffrances ont commencé avant l’arrivée des navires européens en Amérique.
Une véritable réflexion sur le phénomène impérialiste implique d’évaluer l’impérialisme arabe selon les mêmes critères que l’impérialisme européen. Tant que cela ne sera pas fait, l’histoire coloniale restera une demi-vérité et les politiques qui s’en inspirent resteront une entreprise dangereuse. Cette indignation sélective déforme l’histoire et la transforme en arme plutôt qu’en miroir.
Jan Kapusnak est politologue spécialisé dans le Proche-Orient.